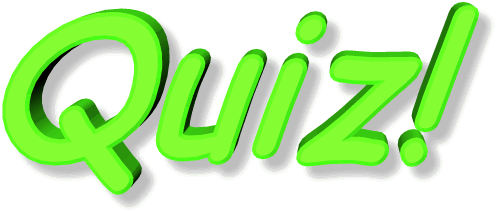"Mon grand-père avait décidé de m'inscrire au lycée Montaigne. Un matin, il m'emmena chez le proviseur et lui vanta mes mérites : je n'avais que le défaut d'être trop avancé pour mon âge. Le proviseur donna les mains à tout : on me fit entrer en huitième et je pus croire que j'allais fréquenter les enfants de mon âge. Mais non : après la première dictée, mon grand-père fut convoqué en hâte par l'administration ; il revint enragé, tira de sa serviette un méchant papier couvert de gribouillis, de taches et le jeta sur la table : c'était la copie que j'avais remise. On avait attiré son attention sur l'orthographe - " Le lapen çovache ême le ten" (le lapin sauvage aime le thym) - et tenté de lui faire comprendre que ma place était en dixième préparatoire. Devant "lapen çovache" ma mère prit le fou rire ; mon grand-père l'arrêta d'un regard terrible. Il commença par m'accuser de mauvaise volonté et par me gronder pour la première fois de ma vie, puis il déclara qu'on m'avait méconnu ; dès le lendemain, il me retirait du lycée et se brouillait avec le proviseur."
Jean-Paul Sartre, Les Mots
"Mais à cette époque, qui n’est pas pourtant si lointaine, le peuple du midi parlait encore la langue romane, la langue d’oc. La Provence était restée une colonie romaine, une terre d’immigration pour les Piémontais, les Lombards, les Napolitains et il y avait dans les écoles publiques beaucoup de petits garçons qui étaient les premiers de leur famille à savoir lire, et à parler français. Les élèves de mon père s’appelaient Roux, Durbec, Laurent. Mais il y avait aussi beaucoup de Lombardo, Binucci, Renderi, Consolini, ou Socodatti. Un jour, un beau petit garçon, qui s’appelait Fiori ou Cacciabua, et dont le père était marbrier, ne vint pas en classe pendant toute une semaine. Quand il revint, mon père lui demanda la cause de son absence. Il répondit que son père l’avait emmené en Italie, pour y voir sa grand-mère, qui était très vieille, et qui ne le connaissait pas. – Je te crois, dit mon père ; mais il faut que tu m’apportes un billet de tes parents qui confirme ce que tu me dis. C’est le règlement. L’après-midi, il remit à mon père une feuille de cahier pliée en quatre. Mon père la déplia, et lut ce message d’un air surpris. Au milieu de la feuille, il n’y avait qu’un seul mot, écrit en lettres majuscules : NAPATOR – Qu’est-ce que ça veut dire ? dit mon père. – Ça veut dire, dit Cacciabua en rougissant, que j’ai dit la vérité, et ça fait que je n’ai pas tort. – C’est parfait, dit mon père, sans manifester le moindre étonnement. Et il mit le billet dans sa poche. Mais à table, il raconta l’histoire à ma mère, et lui montra ce mot étrange, « digne, dit-il, d’être gravé en hiéroglyphes sur le sarcophage de Pharaon… » Il fallut m’expliquer le sens de cette phrase mystérieuse, car j’avais une grande passion pour les mots… L’ignorance du marbrier me fit bien rire : quand on ne sait pas grand-chose, on est toujours cruel pour ceux qui savent encore moins… J’en parlais à voix basse à Florentin, qui en parla à Dubuffet qui raconta la chose à Davin, et Cacciabua devint Napator, ce qui le fit bien rire lui-même ; la gloire de son père n’était pas dans l’orthographe, mais s’épanouissait dans les fleurs de marbre qu’il ciselait sur les tombeaux."
Marcel Pagnol, Le Temps des amours
"Il était devant les rayons de la bibliothèque. Ses doigts suivaient les reliures d’une caresse légère.
– « … Balzac, Barrès, Baudelaire, Beaumarchais, Boileau, Buffon… Chateaubriand, Corneille, Descartes, Fénelon, Flaubert… La Fontaine, France, Gautier, Hugo… Quel appel ! » dit-il avec un rire léger et hochant la tête. « Et je n’en suis qu’à la lettre H !... Ni Molière, ni Rabelais, ni Racine, ni Pascal, ni Stendhal, ni Voltaire, ni Montaigne, ni tous les autres !... » Il continuait de glisser lentement le long des livres, et de temps en temps il laissait échapper un imperceptible « Ha ! », quand, je suppose, il lisait un nom auquel il ne songeait pas. « Les Anglais, reprit-il, on pense aussitôt Shakespeare. Les Italiens : Dante. L’Espagne : Cervantès. Et nous, tout de suite : Goethe. Après, il faut chercher. Mais si on dit : et la France ? Alors, qui surgit à l’instant ? Molière ? Racine ? Hugo ? Voltaire ? Rabelais ? ou quel autre ? Ils se pressent, ils sont comme une foule à l’entrée d’un théâtre, on ne sait pas qui faire entrer d’abord. »
Il se retourna et dit gravement :
– Mais pour la musique, alors c’est chez nous : Bach, Haendel, Beethoven, Wagner, Mozart… quel nom vient le premier ?
« Et nous nous sommes fait la guerre ! » dit-il lentement en remuant la tête."
Vercors, Le Silence de la mer
"Il est un âge où l’on enseigne ce que l’on sait ; mais il en vient ensuite un autre où l’on enseigne ce que l’on ne sait pas : cela s’appelle chercher. Vient peut-être maintenant l’âge d’une autre expérience : celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l’oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l’on a traversés. Cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, que j’oserai prendre ici sans complexe au carrefour même de son étymologie : sapientia, nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse, et le plus de saveur possible."
Roland Barthes, Leçon inaugurale du 7 janvier 1977 au Collège de France
"Le fils de bourgeoisie qui entre en sixième comme il a des bonnes et du même mouvement ne peut pas se représenter ce point de croisement que pouvait être pour moi d’entrer ou de ne pas entrer en sixième ; et ce point d’invention, d’y entrer. J’étais déjà parti, j’avais déjà dérapé sur l’autre voie, j’étais perdu quand M. Naudy, avec cet entêtement de fondateur, avec cette sorte de rude brutalité qui faisaient vraiment de lui un patron et un maître, réussit à me ressaisir et à me renvoyer en sixième. Après mon certificat d’études on m’avait naturellement placé, je veux dire qu'on m’avait mis à l'Ecole primaire supérieure d’Orléans (que d’écoles, mais il faut bien étudier), (qui se nommait alors l’Ecole professionnelle). M. Naudy me rattrapa si je puis dire par la peau du cou et avec une bourse municipale me fit entrer en sixième à Pâques, dans l’excellente sixième de M. Guerrier. « Il faut qu’il fasse du latin », avait-il dit : c’est la même forte parole qui aujourd’hui retentit victorieusement en France de nouveau depuis quelques années. Ce fut pour moi cette entrée dans cette sixième à Pâques, l’étonnement, la nouveauté devant rosa, rosae, l’ouverture de tout un monde, tout autre, de tout un nouveau monde, voilà ce qu’il faudrait dire, mais voilà ce qui m’entraînerait dans des tendresses. Le grammairien qui une fois la première ouvrit la grammaire latine sur la déclinaison de rosa, rosae n’a jamais su sur quels parterres de fleurs il ouvrait l’âme de l’enfant.
Je devais retrouver presque tout au long de l’enseignement secondaire cette grande bonté affectueuse et paternelle, cette idée du patron et du maître que nous avions trouvée chez tous nos maîtres de l’enseignement primaire. Guerrier, Simore, Doret en sixième, en cinquième, en quatrième. Et en troisième ce tout à fait excellent homme qui arrivait des Indes occidentales et dont il faudra que je retrouve le nom. Il arrivait proprement des îles. Cette grande bonté, cette grande piété descendante de tuteur et de père, cette sorte d’avertissement constant, cette longue et patiente et douce fidélité paternelle, un des tout à fait plus beaux sentiments de l'homme qu’il y ait dans le monde, je l’avais trouvée tout au long de cette petite école primaire annexée à l’Ecole normale d’instituteurs d’Orléans. Je la retrouvai presque tout au long du lycée d’Orléans. Je la retrouvai à Lakanal, éminemment chez le père Edet, et alors poussée pour ainsi dire en lui à son point de perfection. Je la retrouvai à Sainte-Barbe. Je la retrouvai à Louis-le-Grand, notamment chez Bompard. Je la retrouvai à l’Ecole, notamment chez un homme comme Bédier, et chez un homme comme Georges Lyon."
Charles Péguy, L'Argent
"Le caractère léger de l’enfance, si difficilement contenu pendant les heures ennuyeuses de l’étude, éclate alors, pour ainsi dire, en cris, chansons et espiègleries, à mesure que ces petits démons se rassemblent par groupes sur le terrain consacré à leurs amusements, et arrangent leurs parties de plaisir pour la soirée. Mais il est un individu qui jouit aussi de l’intervalle de relâche que procure le renvoi de l’école, et dont les sensations ne sont pas aussi évidentes à l’œil du spectateur, ni aussi propres à exciter la sympathie : je veux parler du magister lui-même, qui, la tête étourdie par le bourdonnement des enfants, et la poitrine suffoquée par l’air renfermé de l’école, a passé tout le jour, seul contre une armée, à réprimer la pétulance, à exciter l’insouciance, à tâcher d’éclairer la stupidité et de vaincre l’obstination, et dont l’intelligence même, quelque forte qu’elle puisse être, a été confondue en entendant la même leçon fastidieuse répétée cent fois, sans autre variation que celle des diverses bévues des écoliers. Les fleurs même du génie classique, qui font le plus grand charme de son imagination dans les moments de solitude, ont perdu tout leur éclat et leur parfum en se mêlant aux pleurs, aux fautes et aux punitions ; en sorte que les églogues de Virgile et les odes d’Horace se trouvent inséparablement liées avec la figure boudeuse et le ton monotone d’un écolier bredouilleur. Si à ces peines de l’esprit on ajoute celles d’un corps faible et délicat, et une âme qui aspire à une distinction plus élevée que celle d’être le tyran de l’enfance, on pourra se faire quelque idée du soulagement qu’une promenade solitaire, faite dans une belle et fraîche soirée d’été, procure à une tête qui a souffert et à des nerfs ébranlés pendant tant d’heures de la journée dans la pénible tâche de l’enseignement public."
Walter Scott, Le Vieillard des tombeaux
"Que faut-il donc penser de cette éducation barbare qui sacrifie le présent à un avenir incertain, qui charge un enfant de chaînes de toute espèce, et commence par le rendre misérable, pour lui préparer au loin je ne sais quel prétendu bonheur dont il est à croire qu'il ne jouira jamais ? Quand je supposerais cette éducation raisonnable dans son objet, comment voir sans indignation de pauvres infortunés soumis à un joug insupportable et condamnés à des travaux continuels comme des galériens, sans être assuré que tant de soins leur seront jamais utiles ! L'âge de la gaieté se passe au milieu des pleurs, des châtiments, des menaces, de l'esclavage. On tourmente le malheureux pour son bien ; et l'on ne voit pas la mort qu'on appelle, et qui va le saisir au milieu de ce triste appareil. Qui sait combien d'enfants périssent victimes de l'extravagante sagesse d'un père ou d'un maître ? Heureux d'échapper à sa cruauté, le seul avantage qu'ils tirent des maux qu'il leur a fait souffrir est de mourir sans regretter la vie, dont ils n'ont connu que les tourments.
Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir ; soyez-le pour tous les états, pour tous les âges, pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme. Quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de l'humanité ? Aimez l'enfance ; favorisez ses jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. Qui de vous n'a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les lèvres, et où l'âme est toujours en paix ? Pourquoi voulez-vous ôter à ces petits innocents la jouissance d'un temps si court qui leur échappe, et d'un bien si précieux dont ils ne sauraient abuser ? Pourquoi voulez-vous remplir d'amertume et de douleurs ces premiers ans si rapides, qui ne reviendront pas plus pour eux qu'ils ne peuvent revenir pour vous ? Pères, savez-vous le moment où la mort attend vos enfants ? Ne vous préparez pas des regrets en leur ôtant le peu d'instants que la nature leur donne : aussitôt qu'ils peuvent sentir le plaisir d'être, faites qu'ils en jouissent ; faites qu'à quelque heure que Dieu les appelle, ils ne meurent point sans avoir goûté la vie."
Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l’Education
"Je suis souvent en retard, cinq, dix minutes. Ma mère oublie de me réveiller, le déjeuner n'est pas prêt, j'ai une chaussette trouée qu'il faut raccommoder, un bouton à recoudre sur moi « tu peux pas partir comme ça ! ». Mon père file sur le vélo, mais ça y est, la classe est rentrée.
Je frappe, je vais au bureau de la maîtresse en faisant un plongeon. « Denise Lesur, sortez ! ». Je ressors, sans inquiétude. Retour, replongeons. Elle devient sifflante. « Ressortez, on n'entre pas ainsi ! ». Ressortie, cette fois, je ne fais plus de plongeon. Les filles rient. Je ne sais plus combien de fois elle m'a fait entrer et sortir. Et je passais devant elle, sans rien comprendre. A la fin, elle s'est levée de sa chaise en serrant la bouche. Elle a dit « ce n'est pas un moulin ici ! On s'excuse auprès de la personne la plus importante, quand on est en retard ! Vous l'êtes toujours, d'ailleurs. » La classe pouffe. J'étouffe de colère, tout ce cirque pour ça, pour rien, et, en plus, j'en savais rien ! «Je ne savais pas, Mademoiselle ! - Vous devriez le savoir ! »
Et comment ? Personne, jamais, ne me l'a dit, chez moi. On entre quand on en a envie, personne n'est jamais en retard au café. C'est sûrement un moulin, chez moi. Quelque chose me serre le cœur, je n'y comprends rien, l'école, le jeu léger, irréel se complique. [...] Elle s’est rassise, elle pointe son doigt sur moi en souriant « ma petite, vous êtes une orgueilleuse, vous ne VOULIEZ pas, non, vous ne VOULIEZ pas me dire bonjour ! » [...] Les autres filles sont retournées, elles chuchotent entre elles. Les rires, le bonheur, et tout à coup ça tourne comme du vieux lait, je me vois, je me vois et je ne ressemble pas aux autres."
Annie Ernaux, Les Armoires vides
"On passait par une porte vitrée de la terrasse à la bibliothèque. Aux belles heures de la matinée, cette porte demeurait grande ouverte, en sorte que frère Othon, assis à sa vaste table, était comme en un coin du jardin. J’entrais toujours avec plaisir dans cette pièce au plafond de laquelle jouaient les ombres vertes des feuillages et dont le silence accueillait les gazouillis des jeunes oiseaux et le proche bourdonnement des abeilles.
Devant la fenêtre, un chevalet supportait la grande planche à dessiner, et le long des murs les rangées de livres s’étageaient jusqu’au plafond. La rangée inférieure était prise dans un haut casier aménagé pour les in-folio, le grand Hortus Plantarum mundi, et ces livres enluminés dont l’art est aujourd’hui perdu. Au-dessus courait un rebord que des panneaux à glissière permettaient d’élargir encore, et que des feuillets épars recouvraient, parmi des planches d’herbes jaunies. Ses tables de bois noir portaient aussi une collection de plantes fossiles, que notre ciseau avait détachées dans les carrières à chaux et dans les mines, et parmi elles aussi divers cristaux, ceux dont on expose la beauté, de ceux aussi que les causeurs pensifs aiment soupeser en leurs mains. Au-dessus, s’étageaient les petits volumes, collection d’ouvrages botaniques qui n’était pas des plus étendues, mais sans lacune en tout ce qui concernait les lis. Et cette partie de la bibliothèque se divisait encore en trois branches générales, l’une contenant les œuvres qui s’occupent de la forme, l’autre, de la couleur, la troisième, du parfum. Les rangées de livres se continuaient dans la petite galerie, et le long de l’escalier qui conduisait en haut, jusqu’à l’herbier. Là se trouvaient les Pères de l’Eglise, les penseurs, les auteurs classiques anciens et modernes, et surtout une collection de dictionnaires et d’encyclopédies de toute espèce. Le soir, je retrouvais frère Othon dans la petite galerie, où brûlait dans la cheminée un feu de sarments secs. Quand le travail de la journée avait été bon, nous aimions nous détendre alors en ces conversations plus nonchalantes où l’on chemine sur des sentiers battus, saluant au passage les dates et les autorités. Nous nous amusions aux bizarreries du savoir, à la citation rare, à celle qui frise l’absurde. Et dans ces jeux, la légion des esclaves muets, garrottés de cuir ou de parchemin, nous servait toujours à propos."
Ernst Jünger, Sur les Falaises de marbre
"Roubaud circule, distribuant de grandes feuilles timbrées de bleu au coin gauche, et des pains à cacheter. Nous connaissons toutes la manoeuvre : il faut écrire au coin son nom, avec celui de l'école où nous avons fait nos études, puis replier et cacheter le coin, histoire de rassurer tout le monde sur l'impartialité des appréciations.
Cette petite formalité remplie, nous attendons qu'on veuille bien nous dicter quelque chose. Je regarde autour de moi les petites figures inconnues, dont plusieurs me font pitié, tant elles sont déjà tendues et anxieuses.
On sursaute, Roubaud a parlé dans le silence : épreuve d'orthographe, Mesdemoiselles, veuillez écrire : je ne répète qu'une seule fois la phrase que je dicte. Il commence la dictée en se promenant dans la classe.
Grand silence recueilli. Dame ! les cinq sixièmes de ces petites jouent leur avenir. Et penser que tout ça va devenir des institutrices, qu'elles peineront de sept heures du matin à cinq heures du soir, et trembleront devant une Directrice, la plupart du temps malveillante, pour gagner 75 fr. par mois ! Sur ces soixante gamines, quarante-cinq sont filles de paysans ou d'ouvriers ; pour ne pas travailler dans la terre ou dans la toile, elles ont préféré jaunir leur peau, creuser leur poitrine et déformer leur épaule droite : Elles s'apprêtent bravement à passer trois ans dans une Ecole normale (lever à cinq heures, coucher à huit heures et demie, deux heures de récréation sur vingt-quatre), et s'y ruiner l'estomac, qui résiste rarement à trois ans de réfectoire. Mais au moins, elles porteront un chapeau, ne coudront pas les vêtements des autres, ne garderont pas les bêtes, ne tireront pas les seaux du puits, et mépriseront leurs parents ; elles n'en demandent pas davantage. Et qu'est-ce que je fais ici, moi Claudine ? Je suis ici parce que je n'ai pas autre chose à faire, parce que papa, pendant que je subis les interrogations de ces professeurs, peut tripoter en paix ses limaces ; j'y suis aussi "pour l'honneur de l'Ecole", pour lui obtenir un brevet de plus, de la gloire de plus, à cette Ecole unique, invraisemblable et délicieuse...
Ils ont fourré des participes, tendu des embûches de pluriels équivoques, dans cette dictée qui arrive à n'avoir plus aucun sens, tant ils ont tortillé et hérissé toutes les phrases. C'est enfantin !
- Un point, c'est tout. Je relis.
Je crois bien ne pas avoir de fautes ; je n'ai qu'à veiller aux accents, car ils vous comptent des demi-fautes, des quarts de fautes, pour des velléités d'accents qui traînent mal à propos au-dessus des mots. Pendant que je relis, une petite boule de papier, lancée avec une adresse externe, tombe sur ma feuille ; je la déroule dans le creux de ma main , c’ est la grande Anaïs qui m'écrit : "Faut-il un S à trouvés, dans la seconde phrase ?" Elle ne doute de rien, cette Anaïs ! lui mentirai-je ? Non, je dédaigne les moyens dont elle se sert familièrement. Relevant la tête, je lui adresse un imperceptible "oui", et elle corrige, paisiblement.
- Vous avez cinq minutes pour relire, annonce la voix de Roubaud ; l’épreuve d'écriture suivra.
Seconde boulette de papier, plus grosse. Je regarde autour de moi elle vient de Luce dont les yeux anxieux épient les miens. Mais, mais, elle demande quatre mots ! Si je renvoie la boulette, je sens qu'on la pincera ; une inspiration me vient, tout bonnement géniale : sur la serviette de cuir noir qui contient les crayons et les fusains (les candidates doivent tout fournir elles-mêmes) j'écris, un petit morceau de plâtre détaché du mur me servant de craie, les quatre mots qui inquiètent Luce, puis je lève brusquement la serviette au-dessus de ma tête, le côté vierge tourné vers les examinateurs qui, d'ailleurs, s'occupent assez peu de nous. La figure de Luce s'illumine, elle corrige rapidement ; ma voisine en deuil qui a suivi la scène, m'adresse la parole :
- Vrai, vous n'avez pas peur, vous.
Roubaud promène entre les tables son petit ventre rondelet et recueille nos copies qu'il porte à ses congénères. Puis il nous distribue d'autres feuilles pour l'épreuve d'écriture et s'en va mouler au tableau noir, d'une belle main, quatre vers :
"Tu t'en souviens, Cinna, tant d'heure et tant de gloire, etc., etc."
- Vous êtes priées, Mesdemoiselles, d'exécuter une ligne de grosse cursive, une de moyenne cursive, une de fine cursive, une de grosse ronde, une de moyenne ronde, une de ronde fine, une de bâtarde, une de moyenne et une de fine. Vous avez une heure.
C'est un repos, cette heure-là. Un exercice pas fatigant, et on n'est pas très exigeant pour l'écriture. La ronde et la bâtarde, ça me va, c'est du dessin, presque, mais ma cursive est détestable, mes lettres bouclées et mes majuscules arrivent difficilement à garder le nombre exigé de corps et de demi-corps d'écriture, tant pis ! Il fait faim quand on atteint le bout de l'heure.
Nous nous envolons de cette salle attristante et moisie pour retrouver, dans la cour, nos institutrices, inquiètes, groupées dans l'ombre qui n'est pas même fraîche. Tout de suite, des flots de paroles jaillissent, questions, des plaintes : "Ça a bien marché ? Quel sujet de dictée ? Vous rappelez-vous des phrases difficiles ? "
- C'était ceci - cela - j'ai mis "indication" au singulier - moi au pluriel - le participe était invariable, n'est-ce pas, Mademoiselle ? Je voulais corriger, et puis je l'ai laissé - une dictée si difficile !
Il est midi passé et l'hôtel est loin...
Je bâille d'inanition. Mademoiselle Sergent nous emmène à un restaurant proche, notre hôtel étant trop loin pour aller jusque-là sous cette lourde chaleur.
En attendant l'heure de la composition française, nous sommeillons presque toutes sur nos chaises, accablées de chaleur. Mademoiselle lit les journaux illustrés, et se lève après un coup d'oeil à l'horloge. "Allons, petites, il faut partir. Tâchez de ne pas vous montrer trop bêtes tout à l'heure. Et vous, Claudine, si vous n'êtes pas notée 18 sur 20 pour la composition française, je vous jette dans la rivière. "
- J’y serais plus fraîchement au moins !
Quelles tourtes, ces examinateurs ! L'esprit le plus obtus aurait compris que, par ce temps écrasant, nous composerions en français plus lucidement le matin. Eux, non. De quoi sommes-nous capables, à cette heure-ci ?
Quoique pleine, la cour est plus silencieuse que ce matin, et ces messieurs se font attendre, encore !
En avant la composition française ! Cette petite histoire m'a donné, du coeur.
- Exposez les réflexions et commentaires que vous inspirent ces paroles de Chrysale : "Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, etc."
Ce n'est pas un sujet trop idiot ni trop ingrat, par chance inespérée. J'entends autour de moi des questions anxieuses et désolées, car la plupart de ces petites filles ne savent pas ce que c'est que Chrysale ni Les Femmes savantes. Il va y avoir le joli gâchis ! Je ne peux pas m'empêcher d'en rire d'avance. Je prépare une petite élucubration pas trop sotte, émaillée de citations."
Colette, Claudine à l’école
En cliquant sur l'image, vous trouverez des textes pour vous entraîner à mieux former votre écriture.
1. imprimer
2. repasser le texte en gris
3. deux textes par semaine si école, un texte tous les deux jours si vacances.
En un mois, l'affaire sera réglée !